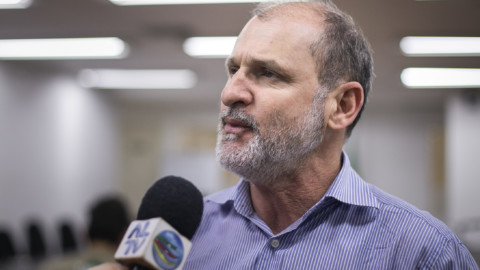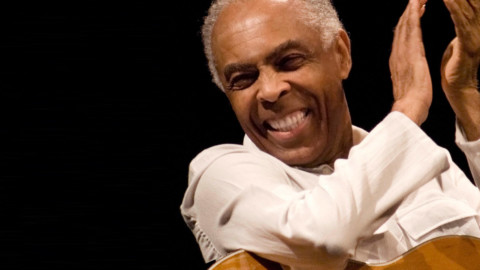Por Damien Hazard (*)
Je suis revenu récemment d’un voyage de neuf jours sur le sol africain, au cours duquel j´ai participé à des rencontres de la société civile et pu ainsi diffusé la réalisation du FSM 2018 en mars prochain à Salvador de Bahia. En Côte-d’Ivoire, le Forum Citoyen Afrique-Union européenne-a réuni des mouvements principalement des régions de l´Afrique de l’Ouest et de l´Afrique Centrale. Au Mozambique, dans le sud-est de l’Afrique, la 5ème Conférence nationale des organisations de la société civile mozambicainea eu lieu. J´ai été plongé dans l’univers social et politique de différentes régions d’Afrique, avec leurs particularités mais aussi leurs problèmes et leurs défis communs. J’ai toujours été exposé à deux points de vue: d’un côté, la version officielle et uniforme des gouvernements et des médias publics et commerciaux, et l’autre une vision plurielle des mouvements sociaux.
En manchette des grand médias africains: la chute du président Robert Mugabé au Zimbabwe, la répression violente par les forces gouvernementales des manifestations de la population au Togo, et l’attaque terroriste dans le Sinaï en Egypte, avec des centaines de personnes tuées. Le continent était également sous le choc des plaintes prouvées et publiées par la CNN sur le commerce des jeunes migrants ouest-africains réduits en esclavage noirs en Libye, relançant et approfondissant la gravité de la problématique des migrations de jeunes dans la région, du racisme et de l’esclavage.
Forum Citoyen en Côte d’Ivoire
À Abidjan, la capitale économique de la Côte-d’Ivoire, au cœur de la région Afrique de l’Ouest, j´ai participé au Forum Citoyen Afrique- Union européenne du 26 au 28 Novembre, avant la tenue de la 5ème édition du Sommet UE-Afrique à Abidjan (les 29 et 30 Novembre): comptan t sur la présence de plusieurs chefs d’Etat européens et africains, l’événement officiel devait traiter principalement des accords de partenariat économique (APE) et de la lutte contre le terrorisme .
Le Forum citoyen a mobilisé environ 1 200 personnes, surtout de l´Afrique francophone, des régions Afrique de l’Ouest et de l’Afrique Centrale : entre autre la Mauritanie, le Sénégal, la Guinée, le Togo, le Burkina Faso, le Mali, le Niger, la Côte d’Ivoire, la République Démocratique du Congo (RDC). Réunis sous le thème « UE-Afrique: Non à un partenariat appauvrissante pour l’Afrique », les mouvements sociaux, les paysans, les pêcheurs, les intellectuels, les jeunes, les ONG et les syndicats ont débattu les conséquences et des stratégies face à la renégociation des accords entre l’Afrique et Union européenne. Des caravanes avaient été organisées et des bus étaient venus du Mali, du Togo, du Burkina Faso, de la Mauritanie et du Sénégal (tous francophones) et s´étaient rencontrés dans le nord de la Côte-d’Ivoire pour descendre ensemble sur la côte, à Abidjan, et participer au Forum Citoyen.
L´événement s’est tenue au siège de l’UGTCI (Union Générale des Travailleurs de Côte d’Ivoire), dénommée Bourse du Travail. Au cours des deux premiers jours, dans un grand auditorium, ont été discutés successivement les impacts du partenariat Europe-Afrique dans le domaine politique, économique et socioculturel sur les peuples et les communautés. Des conférences, des tables de discussion et des groupes de travail ont conduit à la définition de positionnement et de stratégies communes. Parmi les présences marcantes d´intellectuels, peuvent être cités l’économiste ivoirien Mamadou Koulibaly, ancien président de l’Assemblée nationale du pays, et le philosophe, écrivain et penseur congolais (RDC) Godefroid Kä Mana Kangudie.
Le troisième jour, le 28 novembre, ont surgi des changements inattendus. Tôt le matin, la police ivoirienne a encerclé la Bourse du Travail. L’accès a été bloquée pour l’entrée des organisations et des mouvements. Les ordinateurs et les mobiles des membres du comité d’organisation ont été saisis. La situation est devenue tendue. Les organisations ont pu se réunir dans un endroit secret et continuer à travailler, pour finaliser une déclaration, mais la marche a été annulée.
La déclaration finale du Forum Citoyen analyse le contexte des relations entre l’Afrique et l’Union Européenne et formule des recommandations aux gouvernements africains, à l’Union Européenne et aux organisations de la société civile dans le domaine de la gouvernance et de l’alternance démocratique; la protection sociale; les partenariats économiques; la sécurité alimentaire; le régime foncier et la gouvernance des ressources naturelles; la dépendance monétaire et l´évasion fiscale; les changements climatiques; et les migrations.
Le modèle des relations Afrique-Union Européenne
La négociation des accords de partenariat économique UE – Afrique fait suite aux politiques de libre-échange mises en place depuis la Convention de Lomé (1975-2000) et en particulier avec l’accord de Cotonou (2000-2020), qui a créé les APE et établi un cadre de relations essentiellement commerciales et économiques, asymétriques: s´est ainsi consolidée la position d’une Afrique postcoloniale, non industrialisée et fonctionnant comme source de matières premières pour l’Occident. Cette même politique a également conduit à l’endettement des pays africains et à une dépendance économique et monétaire accrue vis-à-vis des pays du Nord. Dans 15 pays africains, se maintient le Franc CFA, hérité de la politique coloniale, contrôlé par des institutions nationales en collaboration directe avec l’Europe et principalement avec la Banque de France. Les gouvernements africains n’ont pas d’autonomie pour intervenir et compenser les variations des taux de change, et sont soumis aux aléas de l’économie européenne.
Du point de vue géopolitique, le nouvel accord APE intervient dans un rapport de forces totalement déséquilibré, entre un bloc, l’Union Européenne, et une Afrique sans centre de décision ni vision stratégique et politique commune. Contrairement à l’image de la pauvreté véhiculée par les grands médias, l’Afrique est riche, très riche. Elle n’a jamais été aussi convoitée pour ses ressources naturelles. Ce qui doit se produire est un véritable pillage des richesses du continent africain, qui a déjà commencé, dénoncent les mouvements. L’accord est promeut les PPP (Partenariat public-privé), et renforcera l’accès et le contrôle des ressources par les pays occidentaux et les transnationales notamment de l’agro-industrie, de l’industrie minière, extractive, et des fonds de pension. Il se présente comme une porte ouverte pour l’accaparement des ressources naturelles, en particulier la terre, l’eau, les graines et la pêche. Le nouvel APE annonce l’appauvrissement, la famine et l’expropriation des communautés et de la population dans son ensemble.
Le philosophe congolais Emmanuel Kabongo Malu dans un article intitulé « L’Afrique appartiendra-t-elle aux Africains en 2050? »[1] explique qu’après des décennies de politiques d’ajustement structurel, le continent est maintenant confronté à une nouvelle phase de politiques d´« ajustement foncier ». L’initiative provient du cœur du néolibéralisme, avec la création en 2004 par le Congrès des États-du Millenium Challenge Corporation (MCC), qui a donné lieu au financement de projets de développement économique dans les pays en échange de la privatisation des terres et l´accaparement des ressources naturelles par les investisseurs. “Aujourd’hui, presque tous les pays d’Afrique noire sont liés au MCC par un contra d´aliénation des ” terres “ancestrales. (…) Les Américains ne sont pas les seuls à faire main basse sur les terres agricoles africaines: la Corée du Sud a acheté la moitié des terres de Madagascar et 700 000 hectares au Soudan; Les investisseurs saoudiens sont en train de prendre le contrôle de la production de riz au Sénégal et au Mali, et l’Arabie Saoudite elle-même a acheté des terres en Tanzanie (500 000 hectares) et au Soudan, la Chine a battu le record en achetant 2,8 millions d’hectares de terres arables. en République Démocratique du Congo (RDC) … L’Inde s’accapare de 765 000 hectares en Ethiopie. ”
Les grands projets développés par les puissances économiques étrangères sont répandus dans divers pays et affectent la vie des populations, en augmentant la mauvaise répartition des richesses et les inégalités. En Côte-d’Ivoire, le poids de la relation se résume en un mot: « Françafrique » , en faisant allusion à la puissance de la France sur le continent, décrit comme impérialiste par une grande partie des mouvements sociaux, en particulier dans les anciennes colonies françaises. Au Mozambique, on parle déjà de « Chinafrica ». Dans ce pays, le Brésil mène lui aussi des grands projets qui recoivent de vives critiques de la part de la population et des mouvements sociaux, comme le programme d´agrobusiness ProSavana (une collaboration entre le Mozambique, le Brésil et le Japon) dans une zone de 11 millions d’hectares, dans la région Nord; ou encore l’exploitation du charbon par l´entreprise Vale, dans la province de Tete. En plus de l’impact environnemental extrêmement négatif de ces projets, les communautés locales expropriées de leurs terres et de leurs demeures n’ont pas été correctement indemnisées et n’ont pas pu retrouver les conditions d une vie digne.
La violence comme instrument de domination
La domination occidentale se traduit également par d’autres instruments de destruction massive contre l’Afrique. Pour Emmanuel Kabongo Malu[2], la violence, sous ses diverses formes, symboliques et concrètes, en fait partie. “Par la violence symbolique, les grands médias occidentaux alimentent l’afro-pessimisme, pour nous maintenir dans un état de subjugation et nous enlever toute capacité de créativité. Cette violence symbolique est l’expression du racisme comme dominante des relations Afrique et Occident, c’est-à-dire le rôle déterminant du projet racial blanc de domination du monde: la suprématie blanche. ”
Parmi les principales chaînes de télévision influentes en Afrique figurent les chaînes multilingues TV5 et Euronews. Le premier, avec des capitaux essentiellement européennes, célèbre ses 25 ans. La seconde le fera en 2018, et est contrôlée principalement par des actionnaires nord-américains (notamment NBC), européennes et un milliardaire égyptien. Selon le professeur Madeleine Mbongo Mpassi[3], l’Afrique dans ces médias est traitée comme un bloc unique, compact et homogène, qui ne tient pas compte de la diversité du continent. Le discours est dominé par les informations sur les catastrophes, les guerres, les famines, la sécheresse, les épidémies, les viols, le banditisme et la misère. Ces chaînes internationales sont très influentes, responsables de la diffusion des principaux sujets politiques, généralement reproduits par les médias nationaux, qui à leur de leur côté orientent leur production vers des programmes de divertissement.
Au-delà de sa dimension symbolique, la violence prend aussi des formes plus concrètes: violence contre les jeunes dans les quartiers périphériques des grandes métropoles, répression des défenseurs des droits humains, guerres qui surviennent dans différentes régions du continent … L’Occident a une responsabilité directe dans les situations de guerre en Libye, au Soudan, au Darfour, au Mali et au Nigeria. Son intervention contribue directement à influencer le démembrement de ces grands pays de l’Afrique Noire, et est toujours liée à des intérêts économiques et financiers.
Démocratie et participation de la société civile, de l’Afrique de l’Ouest au Mozambique
Le projet de développement imposé au continent africain exclut une grande partie de ses populations rurales et urbaines. Les jeunes en particulier voient peu de perspectives d’inclusion sociale et partent à la poursuite d’autres chemins, certains d’entre eux tortueux et risquées. Certains choisissent de rejoindre des groupes terroristes. D’autres partent clandestinement pour rejoindre l’Europe, où ils ont l’intention de s’installer. Les conditions auxquelles sont confrontés les migrants sont dures et inhumaines: traverser le désert du Sahara, en proie à la faim, la soif, la fatigue et la répression des groupes armés et de l’armée aux frontières et sur les territoires nationaux; les risques de capture, d’emprisonnement ou d’asservissement; la dangeureuse traversée de la mer Méditerranée, etc.
« Face à cette situation de désespoir total, nous assistons à des mouvements de jeunesse partout en Afrique pour un développement à visage humain, pour plus de démocratie et une meilleure gestion des affaires publiques. Au lieu de répondre de manière appropriée à ces revendications justes et légitimes, les gouvernements réagissent dans la plupart des cas par la répression. C’est le cas de répressions violentes récemment enregistrées au Togo, au Tchad, en République Démocratique du Congo, au Burundi … » En Côte d’Ivoire, outre l’intervention policière pour empêcher la conclusion du Forum Citoyen, les mouvements de jeunesse ont également été empêchés de réaliser une manifestation de dénonciation et et de répudiation de la situation de mise en escalavage infligée à de jeunes migrants Ouest-Africains en Libye.
La réduction de l’espace de participation démocratique a également fait l’objet d’un débat au Mozambique, au cours de la 5e Conférence nationale de la société civile du Mozambique, organisée par JOINT – Ligue des ONG du Mozambique, qui a réunit du 29 Novembre au 1er Décembre 2017 près de 150 membres d’organisations et de mouvements de toutes les provinces du pays, ainsi que des représentants de partis, du gouvernement et des organisations du Nigéria, du Ghana et du Brésil. Les menaces à l’expression démocratique de la société civile au Mozambique se manifestent de plusieurs façons: la violence policière contre les jeunes dans les banlieues des grandes villes, la criminalisation des mouvements, la législation coercitive, le manque de reconnaissance juridique pour des associations de la part des autorités, comme dans le cas de l’organisation mozambicaineLGBT Lambda, qui n’a jamais été reconnue et enregistrée par le Ministère de la Justice – une condition nécessaire pour pouvoir fonctionner.
Les organisations de la société civile mozambicaine exigent une plus grande participation aux politiques publiques et dans la conduite politique de leur pays. Au Mozambique, une ancienne colonie portugaise, le pays honore les accords de paix signés en 1992 entre les deux grands partis politiques FRELIMO Front de Libération du Mozambique, qui a toujours été au pouvoir depuis l’indépendance en 1975, et l’opposition RENAMO. Le premier président Samora Machel, icône de la libération du Mozambique du joug du Portugal, a tracé le chemin de la reconstruction du pays, en adoptant une organisation socialiste de l’appareil public: nationalisation de l’éducation, de la santé, de la justice, réforme agraire, remplacement de la monnaie coloniale avec l´adoption d´une nouvelle monnaie, le Métical (Mt) … Samora Machel fût assassiné en 1986 et a laissé un pays engagé dans la voie de la reconstruction, mais en proie à une guerre civile dans diverses régions. À ce jour, 25 ans après la signature des accords, la paix au Mozambique doit être relativisée. Ces dernières années, des conflits armés ont éclaté dans certaines provinces entre l’armée gouvernementale et les forces armées de la RENAMO. Au début d’Octobre 2017, le président élu de la commune de Nampula (l’équivalent du maire) a été assassiné. Il était membre du deuxième parti d’opposition dans le pays, MDM (Mouvement Démocratique du Mozambique), qu´il prétendait abandonner. Sa mort crée de nouvelles tensions et soulève des doutes sur le maintien de la paix dans le pays. Pour les mouvements sociaux du Mozambique, l’accord de paix ne peut être établi qu´entre deux partis politiques, ou entre deux chefs de partis et de forces militaires, mais avec tous les acteurs sociaux et politiques du territoire national. L’instabilité entre les forces politiques du pays reflète l’absence d’un large débat sur le projet politique, social et économique voulu pour le pays et pour son peuple.
Des instruments et mécanismes de participation de la société civile aux niveaux national, provincial et local sont mis en œuvre au Mozambique, stimulés par la tendance à la décentralisation des politiques publiques. Une nouvelle loi sur les associations, par ailleurs, qui définit les droits, les devoirs et les lignes directrices régissant les organisations de la société civile, est en cours d´élaboration, discutée avec le réseau JOINT. D’autres processus participatifs pour l´élaboration de lois pour le secteur existent et sont en discussion dans d´autres pays africains comme le Nigéria.
Pour les mouvements sociaux, la reconnaissance du rôle de la société civile organisée passe par le renforcement et l’approfondissement de l´institutionnalité démocratique dans les pays africains: celle-ci fonctionne dans certains pays, mais pas dans d’autres. Cinquante ans après la colonisation, nombreuses nations sont soumises à la domination de groupes d´individus et de familles qui ont confisqué le pouvoir, se sont rendus au modèle de développement imposé par les grandes puissances économiques et ont priorisées leurs propres intérêts au détriment de ceux des peuples. En RDC, par exemple, les enfants du président Kabila, de 9 et 16 ans, sont déjà propriétaires d’entreprises de construction et d´agrobusiness.
Durant le Forum Citoyen à Abidjan, un collectif d’organisations de la société civile en Afrique francophone pour une alternance démocratique, Tournons la Page, a présenté l´amplitude de la problématique: 88% de la population au Togo n´a connu qu´une seule famille au pouvoir ; ce sont 87% au Gabon, 76% Guinée équatoriale et au Cameroun, 69% en République du Congo et le Soudan, 66% au Tchad, 53% en RDC. Des mouvements et des mobilisations surgissent dans de nombreux pays pour revendiquer une alternance du pouvoir, et le renforcement des institutions et des processus démocratiques.
Dans ce contexte, le déclin de Robert Mugabé au Zimbabwe, voisin du Mozambique, en Afrique australe, apparaît comme un événement important, commenté dans tout le continent et dans le monde entier, et qui marque la fin d’une longue dynastie. L’ancien président de 93 ans, au pouvoir depuis l’indépendance en 1980, a tenté d’imposer la candidature de sa femme, contre la volonté de son propre parti et a été évincé par un coup d’Etat militaire. Héros de la révolution qui avait renversé le régime raciste de l’ancienne Rhodésie, dirigé par Ian Smith, Robert Mugabé a conduit le pays dans un processus de développement économique. Mais il s’est accroché au pouvoir. Entre 2000 et 2002, il a chassé les agriculteurs et éleveurs blancs de leurs terres et et de leurs propriétés, sans droit à une indemnisation. Cette décision est restée controversée jusqu´à ce jour, et le nouveau président investi (Emmerson Mnangagwa, le vice!) a promis de reconsidérer la possibilité d´une politique d´indemnisation. La fin de Mugabé apparaît comme une alerte pour les autres présidents africains au pouvoir depuis des décennies. D’un autre côté, il est probable que le changement de régime dans ce pays entraînera l’entrée et la mise en œuvre de grands projets de développement menés par le capital international.
Quelle issue pour le continent africain?
Selon Aminata Traoré, écrivaine malienne, psychologue et ancienne Ministre de la Culture et du Tourisme au Mali: « L‘humiliation du continent africain ne réside pas uniquement dans laviolence, à laquelle l’Occident nous a habitués. Elle réside également dans notre refus decomprendre ce qui nous arrive. »[4] En ce sens, le point de départ de la transformation doit être la prise de conscience de la part des peuples africains quant au processus que traverse le continent. Selon le jeune leader panafricaniste Jean Claude Gnegbré Kado, originaire de la Côte-d’Ivoire, cela signifie pointer et dénoncer l´impérialisme européen en Afrique.
La nécessité d’une conscience historique africaine était déjà soulignée par le Sénégalais Cheikh Anta Diop, un des plus grands historien africain et précurseur de l’idée de fédéralisation du continent africain. L’importance du panafricanisme libertaire reprend toute son importance dans le contexte actuel.
Le modèle économique néolibéral est dénoncé comme la principale source des troubles auxquels le continent africain est confronté. Pour le penseur congolais Kä Mana et pour Tshiunza Mbiye[5], il est nécessaire d’adopter de nouveaux paradigmes d’une économie centrée sur la personne humaine. « Cet enjeu exige que le mouvement de remise en question du néolibéralisme et de remise en cause de l´ensemble de son projet de société et de monde s´intensifie, grandisse, fleurisse, porte des fruits et rende réellement l’avènement d’une nouvelle économie-monde, dans une nouvelle politique mondiale et une nouvelle culture construite autour d’une grande idée, d´un grand idéal et d’une grande vision de l’humanité. »
Pour cela , les peuples africains sont mis au défi de proposer des alternatives basées sur leur propre expérience passée. En ce sens, deux grandes tendances de discours et de visions sur l’Afrique dominent. D’un côté, « un bruyant discours des Africains actuellement fascinés par le glorieux passé de leurs traditions humanistes, depuis l’Egypte pharaonique et l’ère des grands empires africains. On y exalte la sagesse vitale des ancêtres qui ont su construire une économie de communion avec le cosmos, organiser la société autour des idéaux de beauté, de la bonté et de la justice, valeurs cardinales d’un ordre économique splendide. » D’un autre côté, la vision d´une Afrique historiquement misérable, de peuples abandonnés que la colonisation aurait eu le mérite de les extraire du retard dans lequel ils se trouvaient pour les insérer dans l’économie moderne.
Ces deux points de vue sont extrêmes et excessifs, selon les auteurs, et ne correspondent pas à la réalité, beaucoup plus complexe et riche en enseignement. Ces visions cachent la variété des dynamiques et des périodes au travers desquelles les peuples africains sont passés. « On ne peut pas les réduire à un seul shéma simplificateur qui se réduirait à la dichotomie entre le bien et le mal. » Le passé africain en réalité est passé par des hauts et des bas, avec des époques de prospérité et de pénurie, d´« économie de la vie » et d´« économie de la mort ». Mais ce que soulignent Kä Mana et Mbiye, c´est que « à tous les moments où les Africains ont été libres, ils ont été créateurs d’une économie de la créativité qui correspondait à leurs besoins de vaincre la rareté pour faire émerger des périodes d’abondance. (…) C’est la liberté qui nourissait leur sens de la créativité économique. »
L’idée d’une Afrique libre, forte, autonome et souveraine, sans soumission à l’aide occidentale, se renforce. Lors d’une visite au Ghana le 30 Novembre dernier, le président français Emmanuel Macron a entendu de la part du président ghanéen nouvellement élu, Nana Akufo-Addo, la déclaration suivante:
« Nous ne pouvons pas continuer à faire de la politique pour nous, dans nos pays, dans nos régions , sur notre continent, basé sur le soutien que le monde occidental, la France ou l’UE voudraient nous apporter. Ça ne marchera pas, ça n’a pas marché hier et ça ne marchera pas demain. Notre responsabilité est de tracer la voie par laquelle nous pouvons développer nos nations nous-mêmes. (…)
Si nous changeons notre mentalité, cette mentalité de dépendance, cette mentalité qui dépend de l’aide et de la charité, nous verrons que, dans les prochaines décennies, une nouvelle race de jeunes Africains va surgir. Et cette nouvelle mentalité africaine, dans laquelle nous parlons d’indépendance, sera une réalité de notre temps. »
———————–
[1] Kabongo Malu, Emmanuel – L´Afrique appartiendra-t-elle aux Africains em 2050?, p.24-25, Revista Renaissance n°18, Le Magazine de l´Afrique Libre, 25/11 a 15/12/2017.
[2] Kabongo Malu, Emmanuel – L´Afrique appartiendra-t-elle aux Africains em 2050?, p.24-25, Renaissance n°18, Le Magazine de l´Afrique Libre, 25/11 a 15/12/2017.
[3] Les mensonges du Globe terrestre – Madeleine Mbongo Mpassi, p.21-22, Renaissance n°18, Le Magazine de l´Afrique Libre, 25/11 a 15/12/2017
[4] L´Afrique Humiliée – Aminata Traoré, Editions Fayard, 2008.
[5] Le nouveau paradigme de notre temps, le sens humain de l´économie – Kä Mana e Tshiunza Mbiye, Renaissance n°18, Le Magazine de l´Afrique Libre, p.35-37 – 25/11 a 15/12/2017
(*) Coordinateur de Vida Brasil, directeur de l´Abong (Association Brésilienne des ONGs) dans l´état de Bahia (Brésil) et membre du Conseil International do FSM